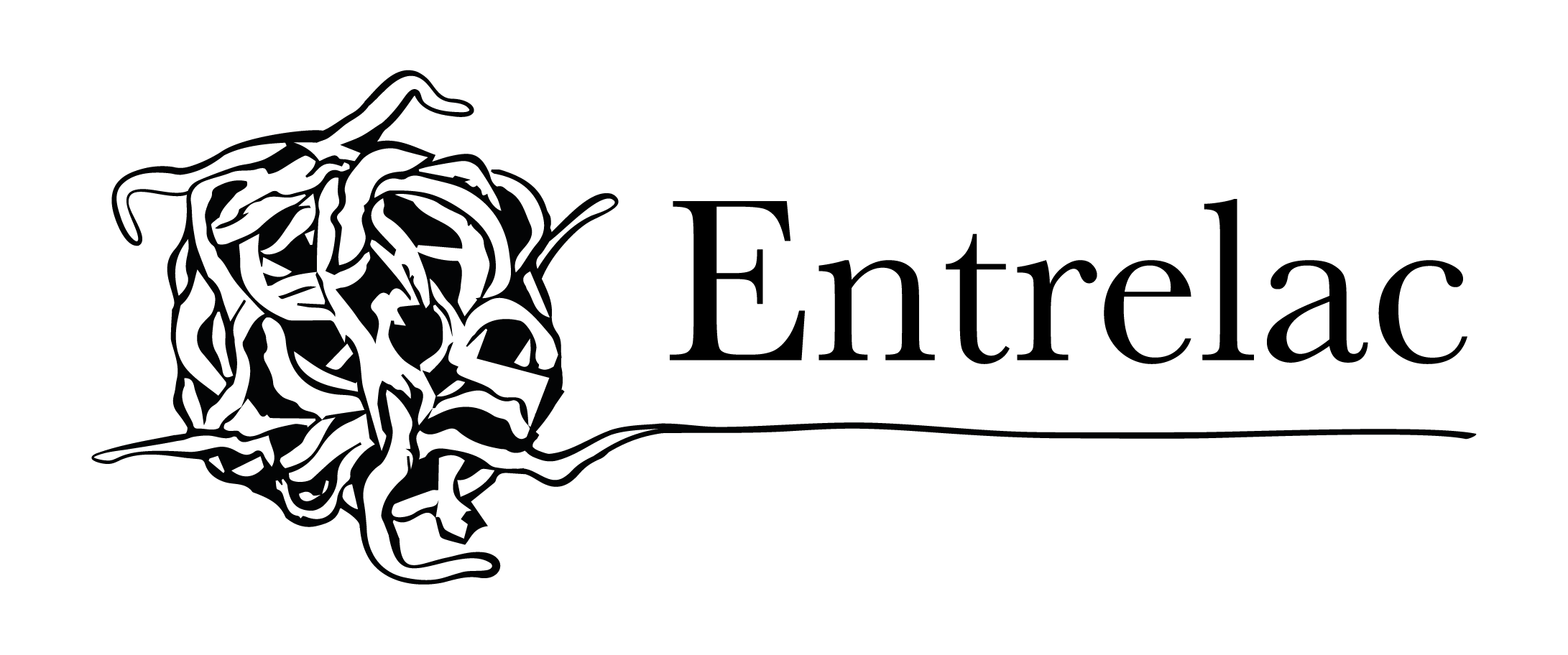Une brève histoire du monde
Nous commençons donc par l’Est. L’aube de l’esprit est à l’Est, là où le soleil se lève. [Mais] l’esprit n’est qu’à son déclin. Nous commençons donc par le principe asiatique. Le terrain, pour cette vie, ce sont les régions de plaines, non les montagnes et les gorges. Il se peut que, historiquement, une existence antérieure d’autres peuplades puisse être établie, sur les versants des montagnes qui mènent aux régions de plaines, mais seule l’existence éthique est historique, et donc ce qui nous intéresse, c’est seulement un peuple éthique. Un tel peuple éthique se trouve d’abord dans les régions de plaines et les régions fluviales.
Chine
Le premier [moment] est donc le monde oriental en Extrême-Orient, l’histoire de Chine, des Indiens, des Tibétains, des Mongols. Ce par quoi il faut commencer, ce sera la Chine. La Chine est cet empire d’une merveilleuse singularité qui plongea les Européens dans l’étonnement dès qu’il fut connu, et qui les y plongera encore. Considéré en soi, cet empire s’est élevé à cette culture sans avoir eu de rapports avec l’étranger. Ses rapports avec d’autres peuples sont tout récents et sans aucune importance pour cet empire. C’est le seul empire au monde à s’être conservé depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. Nous avons déjà remarqué sa grandeur propre, pour ce qui concerne les frontières. En l’état actuel, le peuplement de l’Empire chinois proprement dit s’élève en moyenne à 200 millions d’âmes, les estimations les plus basses comptent 150 millions, les plus hautes 300 millions. Il y a toutes les quelques années un recensement, et c’est d’après lui que sont établies des listes très exactes d’impôts [à prélever]. Les données sont donc justes. Sont exclus du chiffre donné ci-dessus la Tartarie chinoise et les nombreux princes, aux alentours, qui gouvernent leurs propres territoires sous la domination indirecte de la Chine. Ce peuplement énorme de la Chine proprement dite est soumis à un gouvernement réglé au plus haut point, qui est suprêmement juste, suprêmement bon, suprêmement sage. Les lois sont développées et l’agriculture, le commerce, l’industrie et les sciences prospèrent. Il existe des villes de plusieurs millions d’habitants.
Ce qui est encore plus admirable, c’est que ce peuple a une histoire cohérente, bien ordonnée, très bien attestée depuis les temps les plus anciens à travers au moins 5 000 ans, avec la plus grande précision et la plus grande certitude, mieux attestée encore que l’histoire grecque et romaine. Aucun pays du monde n’a une histoire aussi ancienne, aussi attestée et aussi cohérente. Cet empire est toujours resté pour soi, subsistant par soi, il est toujours resté ce qu’il était. Il a été envahi une fois au XIIe siècle par Gengis Khan, plus tard, au temps de la guerre de Trente Ans, par les Tartares du Mandchou, mais sans avoir été modifié pour autant. Il a toujours gardé son caractère à travers toutes les relations, car il est entièrement resté l’empire subsistant par soi. Et il s’agit par conséquent d’un empire non historique, car il s’est tranquillement développé en soi, il n’a pas été dérangé par l’extérieur. Aucun principe étranger ne s’est installé à la place de l’ancien. Dans cette mesure, il n’a pas d’histoire. Ainsi, en parlant de l’histoire la plus ancienne de cet empire, nous ne parlons aucunement de quelque chose de passé mais de la figure la plus récente du présent. (Il en va de même en Inde.) Il nous faut indiquer de façon générale le principe de cet empire – principe dont il n’a pas outrepassé le concept ; il est étonnant que ce principe ne soit que le concept naturel d’un État et qu’il conduise en même temps à une élaboration qui n’a pas transformé ce premier principe de l’enfance. Pourtant nous trouvons ici la culture la plus haute.
Il ne peut donc être question d’une histoire à proprement parler.
Inde
C’est la vallée fluviale de l’Indus et du Gange. Ici commence déjà un entrelacement plus marqué avec les montagnes. l’Inde est ouverte sur le reste du monde, aussi apparait-elle comme un maillon actif dans l’enchainement de l’histoire mondiale, alors que l’empire chinois se tient à l’écart de celui-ci, est un terme premier mais qui n’a pas encore commencé et qui n’est pas non plus allé hors de soi. L’Inde se montre d’emblée à la représentation comme un peuple de l’histoire mondiale. De là, on a retiré une sagesse, un savoir, une culture, ainsi que des trésors de la nature. Il n’est rien qui n’en soit issu. Aussi tous les peuples ont-ils tourné le regard vers l’Inde, afin d’y trouver une voie pour accéder aux trésors. Se procurer une connexion avec cette source est un moment par lequel passent les peuples. Il n’y a pas de grande nation qui n’ait acquis en Inde une parcelle de terre, petite ou grande.
[1.] Essayons d’abord [de] saisir le principe indien, par opposition au principe chinois. Par rapport à la Chine, l’Inde apparaît comme le pays de l’imagination, le pays du merveilleux. En Chine, tout était entendement dénué d’imagination, vie prosaïque, où même le cœur (Gemüt) est déterminé de l’extérieur, fixé et légalement réglé ; en Inde, en revanche, il n’est pas d’objet qui soit fixé de façon déterminée face à la poésie et à l’imagination ; tout objet est au contraire transformé par l’imagination, rendu merveilleux. En Chine, la morale est le contenu de la loi ; en Inde, il y a aussi, bien entendu, des règles et des lois fixes, et même une masse énorme de déterminations du comportement, mais ces déterminations n’ont pas pour contenu l’éthique, la vie du cœur, la morale ; elles ont pour contenu la superstition. Ce sont des actions qui, dans leur forme comme dans leur contenu, sont dénuées d’esprit et de cœur. La vie des Indiens se compose de ces formes dénuées d’esprit et de cœur. Les Chinois, avec d’un côté leur rationalité prosaïque, de l’autre leur maître qui règne sur tout, sont constamment superstitieux face à la rationalité d’entendement. Chez les Indiens, il n’y a pas de superstition du genre de celle des Chinois, mais c’est l’ensemble de leur situation qui est à concevoir comme une rêverie. Rationalité, moralité, subjectivité sont niées, rejetées ; aussi l’homme n’en vient-il à lui-même, à quelque chose de positif, que par la débauche de l’imagination. D’un côté, une imagination sauvage avec une jouissance sensible, de l’autre une abstraction de l’intériorité totalement morte, voilà les extrêmes entre lesquels sont ballottés les Indiens. L’Indien est ainsi comme un homme tombé au plus bas qui, délivré et libéré de toute spiritualité, et s’abandonnant au désespoir, se forge grâce à l’opium un monde rêvé, un monde, un bonheur délirants. Chez les Chinois, l’historiographie est la science que l’on cultive le plus. Chez les Chinois, nous l’avons vu, l’histoire est ordonnée et réglée durant 5 000 ans, sur le mode d’une chronique ; on trouve des récits en prose sur le monde extérieur, sur les faits (Taten), sur les événements, auxquels se mêlent çà et là des enseignements moraux. Chez les Indiens, en revanche, une histoire, une chronologie, la présentation d’une effectivité sont impensables. Pour eux, tout ce qui est présent et consistant s’évapore en rêves bigarrés. Chez eux, toute histoire véritable est donc impossible. Chez eux, l’appréhension est conditionnée par une faiblesse, une irritation nerveuse, qui les empêche de supporter les objets, de supporter un être-là fixe, déterminé ; dès que ce dernier entre en contact avec eux, il se transforme au contraire pour eux en un rêve fébrile. Ils ne peuvent supporter aucune effectivité déterminée, et il leur faut rêver et mentir. Ils sont tout aussi peu capables de mentir en sachant qu’ils le font. On peut tout aussi peu se fier à leurs écrits qu’à leurs récits. Voilà les premiers traits. Le nom d’Inde a fait se propager dans la représentation un rêve, un beau parfum ; mais, parce que, plus récemment, on s’est familiarisé avec l’esprit indien, ce parfum s’est dissipé, il s’est évaporé. Le jugement découvre maintenant tout autre chose que ce que l’imagination se représentait de ce pays merveilleux.
À présent, il faut saisir le principe indien de façon plus précise. Chez les Chinois, nous trouvions le principe patriarcal qui gouverne des êtres mineurs. Les Chinois sont dépourvus d’intériorité accomplie ; leur intériorité n’a pas de contenu. Le contenu de l’autodétermination leur est donné dans un gouvernement extérieur, dans des lois extérieures qui le déterminent. C’est l’intériorité la plus abstraite. Le pas suivant est une progression nécessaire, consistant en ce que se crée un monde de l’intériorité ; C’est donc dans le devenir d’un monde intérieur que réside l’accomplissement. Chez les Chinois, le monde du penser n’existe qu’en relation à l’État et à l’utilité. La progression ultérieure est que la déterminité qui était auparavant posée de l’extérieur devienne intérieure, qu’elle se configure en un monde spirituel, que l’intérieur ne soit pas seulement abstrait, que l’esprit s’édifie son propre monde à partir de soi, et que le monde se configure en un idéalisme.
Cette progression, nous la percevons en Inde, mais l’idéalisme y est un idéalisme dénué de raison, un idéalisme de la pure imagination, sans liberté, un pur rêve, où la vérité n’est qu’un jeu intérieur, et où la masse du contenu est l’imagination abstraite. Ce qui est objectif apparaît comme une imagination de l’esprit, mais dénuée de concept et, partant, non libre. Aussi la vie indienne est-elle une vie rêveuse.
Perse
Ici nous pourrons être plus bref, d’un côté parce que nous avons moins de matériaux, de l’autre parce que ceux-ci nous sont plus familiers. Les matériaux qui concernent l’Empire (Reich) perse sont cependant très lacunaires. C’est seulement avec cet empire que nous entrons dans l’histoire mondiale proprement dite. La Chine se tient hors des connexions de l’histoire mondiale, bien qu’elle en soit un moment important, essentiel ; de même l’Inde, l’autre moment, qui ne possède qu’une connexion interne à l’histoire mondiale ; elle passe sans actes, sans bruit, silencieusement.
[…]
Si nous considérons de plus près l’Empire perse, nous trouvons ici pour la première fois un empire, c’est-à-dire un tout du pouvoir qui rassemble en soi des éléments totalement hétérogènes (d’une hétérogénéité, à vrai dire, relative). Les peuples qui furent ici réunis sont extrêmement différents par la langue, les mœurs, la religion. Cet empire a duré très longtemps avec beaucoup d’éclat, et, à y regarder de plus près, il faut considérer ce mode de connexion comme quelque chose qui s’approche davantage de l’Idée de l’État que les moments antérieurs. Car il n’y a ici ni (organisation) morale-patriarcale comme en Chine, ni différences rigides comme chez les Indiens. Ce n’est ni le torrent mondial vite interrompu des Mongols, ni le négatif de la répression de l’Empire turc. On perçoit ici au contraire une unité de peuplades qui ont conservé leur subsistance par soi et dépendent pourtant d’un point unifiant qui les maintenait en équilibre [et] pouvait permettre leur satisfaction. Le monde indien et mongol appartient à l’Extrême-Orient, [et] le sentiment que l’on a de soi-même en Extrême-Orient est très différent du nôtre. Il en va encore autrement dans ce qui dépend de la Perse. Dans la Perse actuelle, on a affaire à une autre race, à une espèce d’hommes plus belle, qui s’apparente à l’espèce européenne. Elphinstone, un Anglais, affecté à la surveillance de cette région, a visité le royaume de Kaboul et le Cachemire, et nous a familiarisés avec eux. Il décrit l’impression selon laquelle il y a une différence entre la Perse et l’Inde, et il dit que, jusqu’à l’Indus, un Européen peut encore se croire en Europe. Dès que l’on franchit l’Indus, tout est différent. En arrivant en Perse, nous trouvons l’Empire orienté vers l’extérieur, et par là dès le début en contact avec l’histoire mondiale.
Indiquons maintenant au sein de cet empire ce qui en est le principe : la réunion des principes précédents. En Perse, le principe chinois et le principe indien sont réunis. En Chine, la réunion du tout était sous la domination d’une volonté morale extérieure qui détermine la volonté la plus intime de l’homme. Le principe de l’Inde, en revanche, était celui de l’absolue différence, en une pétrification naturelle. Dans l’Empire perse, nous voyons aussi la différence d’individualisation extérieure sous la forme des nations, mais de telle sorte que les différences, qui peuvent se développer librement et sont pourtant surmontées par un point unifiant, sont maintenues unies. Ici la libre individualisation fait donc retour à un point qui la maintient unie ; c’est le troisième moment nécessaire. Il nous faut considérer de plus près les différences dont l’unité est le tout.
[…]
En ce qui concerne cette religion des mages, elle est l’élément le plus élevé, l’élément spirituel des Perses en général. Comme nous le voyons dans la religion perse, c’est un culte de la nature, mais sans idolâtrie, totalement différent de la dépravation indienne ; c’est au contraire un souffle plus élevé qui se répand sur nous. Ce ne sont pas les choses singulières de la nature, comme le soleil, la lune, qui constituent l’assise des figures que l’on vénère. Même si chez les Indiens ce sont également des activités universelles saisies par la pensée qui sont rassemblées en figures, le sens de ces figurations est encore lui-même quelque chose de sensible, une activité seulement naturelle. Nous avons vu que Brahman était une unité indéterminée et non l’effectif concret de l’esprit. Chez les Perses, il y a certes également un culte de la nature, mais c’est uniquement celui de la lumière, cet être physique, universel, simple, qui est aussi pur que la pensée. La pensée pressent, elle se ressent en quelque sorte elle-même, lorsqu’elle a devant soi la lumière. Assurément, les Perses ne se sont pas représenté la lumière à la manière de Newton. C’est dans la vénération que la lumière est donnée, et non exclusivement dans l’intuition sensible. Mais c’est le cœur (Gemüt) qui, dans cette intuition, va en soi et fait ainsi de l’objet quelque chose qui voit au-dedans de soi, et cet être au-dedans de soi du pur objet, la lumière, est alors immédiatement de la pensée, du spirituel en général. La pensée libre n’est pas encore l’assise libre, mais on intuitionne quelque chose de sensible. C’est toutefois un sensible saisi comme entièrement universel, donc dans la forme du penser et, dans la mesure où l’on connaît ce sensible comme intérieur, la signification devient une pensée, un connaître, un savoir, un bien. Tel est le point de vue le plus élevé des Perses en général. Leur âme s’est donc élevée à cette pureté plus haute qu’est un sensible dans la forme universelle du penser.
Grèce
Il convient de dire, en ce qui concerne la vie grecque, qu’il n’y a pas encore en elle d’activité, d’effort pour acquérir l’entendement abstrait, qui se représente un but tiré de l’universalité et s’épuise à y travailler. Ce qui existe ici est la vitalité concrète, encore sensible, qui, née de ce qui est spirituel, a cependant une présence sensible – c’est cette unité, cette interpénétration de l’esprit et du sensible, que nous voyons également chez les Asiatiques, qui se présente toutefois maintenant non plus en étant immédiatement, mais au contraire comme née de l’esprit, comme une sensibilité spiritualisée, qui est pour l’esprit. Nous avons ainsi chez les Grecs l’intuition sensible-spirituelle des Orientaux, mais produite à partir de l’individualité, de l’esprit individuel. C’est pourquoi le monde grec est fondé sur le monde oriental, il commence à partir de la naturalité divine, mais il la reconstruit, il lui insuffle l’élément spirituel comme son âme intérieure. Tel est le principe grec.
[…]
Le soleil suit son cours du matin vers le soir, et nous allons donc de l’Asie vers l’Europe, l’Occident. Nous devons tout d’abord considérer le pays des Grecs. Le quatrième [milieu] local que nous rencontrons, par-delà la mer, est constitué par la multitude des iles de la mer Égée et par une terre ferme, qui ressemble elle-même à une île : elle est formée en partie par de véritables presqu’iles, en partie par une foule de langues de terre étroites, et est découpée en maints endroits par des baies. À l’intérieur des terres domine une multiplicité [de reliefs] : alternance de séries de collines, de montagnes, de plaines étroites, de vallées traversées par de petites rivières. Ce pays ne possède pas de grands fleuves qui coulent dans des plaines nourrissant de leur sol fertile une lignée particulière, à laquelle le ciel tout entier n’impose qu’une seule forme de dépendance. En Grèce, les diverses parties du pays sont reliées facilement entre elles. Tel est le caractère élémentaire du [milieu] local et de l’esprit grec : une individualité se dressant pour soi, qui n’est pas unie dès le départ par un pays aux mœurs patriarcales, mais qui se dresse pour soi, individuellement, et qui doit s’unir dans un milieu, une loi et des mœurs spirituelles plus élevées.
[…]
Le commencement de la vie grecque nous montre un mélange, un métissage et une migration de tribus et de peuples, dont nous ne savons pas dans quelle mesure ils étaient de nature grecque, et de tribus, dont nous savons que leur nature n’était absolument pas grecque. La naissance du peuple athénien – d’Athènes, où se trouve le sommet de l’esprit grec – provient du fait qu’il était un refuge pour des individus de différentes tribus, de familles et de peuples les plus divers. De même les Perses, le véritable Empire asiatique, sont un groupement de tribus étrangères les unes aux autres, de natures différentes, et les Romains également étaient un colluvies de peuples de différentes nations, qui étaient solidaires les uns des autres sans aucuns liens familiaux, mais par le pur intérêt du brigandage. En Europe, toutes les nations sont nées d’une fusion [entre des peuples]. L’élément de la diversité est donc essentiel à un peuple de l’histoire mondiale. Les Grecs, les Romains, les Germains ne se sont unifiés qu’à partir d’une diversité. C’est la condition nécessaire pour un peuple qui peut prétendre avoir une signification historico-mondiale.
[…]
Cette impulsion joyeuse du sentiment de soi, qui s’impose contre le sentiment de soi à son état fruste, le simple sensible, constitue la principale détermination des Grecs, et cette impulsion se développa chez eux sous la forme des beaux-arts. Elle débute par un apaisement, qui n’est nullement le remède à un manque, mais provient de ce qui, dans la nature humaine, a été préservé de tout dépérissement. Le commencement de l’art grec est subjectif. Son premier moment est celui d’un travail qui n’est pas le fruit du besoin et consiste en ce que l’individu fait quelque chose de lui-même, qu’il satisfait les autres et leur montre qu’il porte la marque de l’universalité, de la validité universelle. Le premier commencement subjectif est pour cette raison celui par lequel le Grec fait de son propre corps quelque chose, une libre mobilité. Il consistait dans la formation achevée du corps, dans la transformation du corps en une œuvre d’art. C’est ce que nous voyons dans les temps les plus anciens.
Rome
Napoléon dit à Goethe que ce qui ferait l’intérêt de la tragédie, ce serait le destin ; et que chez nous, comme nous n’aurions plus ce fatum des Anciens, la politique pourrait prendre sa place. C’est à l’irrésistible violence de deux circonstances, au but de l’État, et à son autorité – c’est à cet [élément] irrésistible que doivent nécessairement succomber les simples particularités, les individualités ; et [ce qui vient à leur place], c’est la politique en tant que pouvoir, qui ne peut pas laisser faire les individus, mais doit les sacrifier.
Tel est l’acte de l’Empire romain : le pouvoir comme universalité simplement abstraite, par lequel le destin, l’universel abstrait, a fait son entrée dans le monde. Dans l’Empire romain, la vie de la particularité est enchaînée. Rome a rassemblé et enfermé tous les dieux et tous les esprits dans le panthéon de sa domination mondiale, elle a accumulé tous les malheurs et toutes les douleurs. Elle a brisé le cœur du monde, et c’est seulement à partir du cœur du monde qui se sent malheureux, à partir de cette tristesse de la naturalité de l’esprit, que l’esprit libre put se développer, s’élever.
Nous avons, dans le monde grec, l’individualité ; dans l’Empire romain, l’universalité abstraite. Ce qui est concret dans cette universalité, c’est seulement l’égoïsme, la domination prosaïque, pratique. Chez les Romains, nous n’avons donc pas affaire à une vie spirituelle et libre en soi, une vie qui prendrait plaisir à une intuition théorique, mais il s’agit seulement d’une vie inerte, d’une vitalité qui ne prend pour but que ce qu’elle comprend pratiquement, pour faire valoir l’universel rigide, qui se maintient en pratique. Par conséquent, nous pouvons être bref, puisque c’est à ces déterminations que se réduit la diversité du matériau.
Ce dont il faut parler en premier, c’est de l’esprit romain, de manière générale.
Pour ce qui concerne le milieu local, l’histoire mondiale se déplace [ici] plus vers l’Ouest. Elle se trouve encore en deçà des Alpes, sur le théâtre de la Méditerranée, c’est seulement plus tard qu’elle va vers le Nord. Rome fut fondée près d’un fleuve, qui n’est cependant plus l’élément chaud et accablant qu’il est en Orient, mais qui ne forme pas de vallée fluviale comme en Asie, c’est plutôt sa connexion avec la mer qui fait son intérêt. Rome a en même temps une base solide dans les terres, elle est en retrait par rapport à la mer, alors que Tyr et Carthage se sont formées simplement en se tournant vers la mer. Si cependant nous devons dire dans quel territoire l’Empire romain aurait eu son origine, il n’y en a aucun que l’on peut indiquer, et l’on pourrait dire que Rome se serait formée hors [de tout] territoire. Car ici, ce qui est venu en premier, ce fut le centre, à l’inverse de la Grèce, et ensuite est venue l’expansion de ce centre. Trois domaines se rencontrent en ce point : celui des Latins, celui des Sabins et celui des Étrusques ; où il est indifférent [de savoir] quel est celui dont Rome fait davantage partie. Rome apparut d’abord à cette intersection.
Monde germanique
Au commencement, il est impossible que la particularité soit déjà unifiée avec la fin ultime absolue ; les fins particulières en diffèrent encore, et la volonté particulière commence par méconnaître sa fin ultime absolue, elle est en conflit avec soi. Elle veut cette fin, mais elle méconnaît cette impulsion, elle méconnaît ce qui constitue son intérieur véritable, elle se débat dans des fins particulières et est ainsi en conflit avec elle-même. Dans ce conflit, elle combat ce qu’elle veut vraiment, et, en le combattant ainsi, c’est l’absolu lui-même qu’elle produit. L’élément moteur est donc la volonté particulière, qui au départ possède ses fins finies. Le vrai est le fait d’être-poussé vers la fin ultime absolue. La volonté est poussée par le vrai, mais cet être-poussé, l’impulsion, est d’abord ce qui est confus, et c’est pourquoi, souvent, il nous faut juger aujourd’hui des événements d’une façon qui est l’inverse même de la façon dont ils apparaissent dans l’histoire des peuples. Ce qui est le malheur d’un peuple, ce qui a fait son malheur, ce peuple et l’histoire l’ont qualifié de bonheur suprême, tandis qu’ils combattaient le bonheur comme un malheur suprême. Les Français disent : « La vérité, en la repoussant, on l’embrasse ». C’est ce qui arrive dans l’histoire européenne qui n’accède à sa fin ultime qu’en repoussant la vérité. C’est ainsi que l’Europe a agi, c’est ainsi que l’homme moderne s’épuise dans les combats les plus sanglants. La volonté du monde moderne est donc une volonté confuse, à l’arrière-plan de laquelle se trouve la vérité, [une volonté qui] combat ce qui est en et pour soi, qui s’épuise en ce combat et qui trouve sa satisfaction là où, souvent, réside le contraire du vrai.
[…]
À présent, mentionnons rapidement les royaumes qui en sont nés [de la chute de l’empire romain]. La première partie, la partie méridionale et occidentale de ces territoires, sur lesquels l’histoire mondiale exerce sa compétence, inclut les territoires que les Romains avaient eus longtemps en leur possession, et [qui] étaient développés sur le plan de la civilisation, de l’artisanat, de l’art et du style de vie. En font partie l’Espagne, le Portugal, la France, où s’étaient établis, vers la fin du VIe siècle, les Alamans et les Slaves. Plus tard, s’en distingue le royaume des Francs qui a déferlé sur la France, à partir de la Basse-Rhénanie et de la Basse-Allemagne, et qui s’y est imposé. Ensuite, la troisième partie est la Bretagne, où ont émigré les Angles et les Saxons, ainsi qu’en partie les Normands, qui ont dévasté toutes les côtes d’Europe ou qui s’y sont fixés durablement. Il convient de mentionner en outre l’Italie, où le royaume des Ostrogoths, sous Théodoric et Totila, a acquis un éclat et une apparence de grandeur, parce que la grandeur des Romains, leur civilisation, semblait s’unir ici à l’élément étranger ; mais il fut de courte durée. Il brilla de ses derniers feux avant de disparaître, disloqué en soi ; et ce sont les Lombards de Pannonie, ce peuple goth dont les origines se situent sur les côtes de Scandinavie, qui lui succédèrent et qui s’y établirent. On dit que les Goths viennent de Scandinavie, parce que c’est à partir du Nord qu’ils ont déferlé sur l’Empire romain d’Orient, puis sur celui d’Occident. Le royaume de Lombardie fut ensuite conquis par les Francs, l’Italie du Sud devint la possession des Normands, et l’Église gagna bientôt et reçut, elle aussi, des possessions indépendantes. Les Francs fondèrent un royaume burgonde, qui par la suite a eu pour rôle de constituer un mur de séparation entre la France et l’Allemagne. Ce que tous ces territoires ont de spécifique est que des Barbares s’y mêlent à des peuples civilisés. Le tout issu de ce contraste prodigieux, qu’à vrai dire les Barbares rendirent moins aigu en dévastant tout et en détruisant l’essentiel de la civilisation, ce sont, en Italie, deux nations, qui vont toutefois se fondre en une seule.
L’Allemagne, en revanche, se préserva purement pour soi. C’est seulement sur ses confins, sur le Neckar et le Danube, qu’elle avait été romaine. Plus loin, à l’est et au nord, l’Allemagne était restée libre ; [elle était restée] une nation en soi, quoique non pas un État, un tout ; une nation, ce qui veut dire qu’elle était une en soi, non pas une et la même, mais telle que, dans chaque territoire, elle était une ; Alamans, Thuringeois, Bavarois, Saxons, etc., étaient distincts les uns des autres.
Plus loin vers l’est, des nations slaves vont bientôt s’étendre le long de l’Elbe, puis on voit pénétrer en leur sein des Hongrois, des Magyars, venus du sud, de la Saxe, de la Bavière. Encore plus loin vers l’est, à l’ouest de la Grèce, on trouve les Russes ; au sud-est, des Albanais, des Alains et des Bulgares – des peuples d’origine asiatique, des Barbares asiatiques – qui restent là-bas. Beaucoup de choses ont disparu, il n’est pas resté grand-chose de ce flux et de ce reflux des peuples. Cette partie slave n’accède pas au domaine de l’histoire, de même que la partie orientale qui, à l’époque contemporaine, est encore, elle aussi, quelque chose de concentré en soi.
À présent, examinons de plus près la déterminité qui distingue les États. La première partie de ces États, de ces nations, s’est formée à partir du naturel romain et germanique. Le tout de l’existence spirituelle de la vie voulante et consciente d’elle-même est ainsi, dans ses racines, quelque chose de divisé. La distinction ainsi fondée a également sa marque la plus visible dans la langue, qui résulte d’une interaction entre des éléments romains antiques ou des éléments autochtones plus antiques encore, et des éléments germaniques. Nous pouvons nommer cette langue la langue romane, et elle a pour domaine – outre l’Italie – la France, l’Espagne et le Portugal.
L’autre partie se caractérise par le fait de n’avoir pour racine aucun mélange ; elle comprend trois États : l’Allemagne, la Scandinavie et la Bretagne, que la civilisation romaine a pu pénétrer, mais comme on pénètre une île, seulement à ses confins. Les envahisseurs saxons avaient davantage à voir avec la population autochtone. Aussi se sont-[ils] mêlés aux anciens peuples qui étaient là, dont le roi était Arthur de Galles – à un élément qui présentait une plus grande homogénéité avec eux. Les Romains s’étaient déjà retirés de la Bretagne depuis quarante ans lorsque les Saxons y arrivèrent, conquérant d’abord le Kent, puis la Cornouaille, au XIe siècle seulement. Par la suite intervinrent les Normands. Toutefois tout ce qui s’est réuni ici était davantage quelque chose d’homogène. Le caractère de ces peuples, la détermination fondamentale de leur caractère, est donc l’unité indivise, indistincte, de leur civilisation, une intériorité, une subjectivité sans brisure. Cette intériorité apparaît d’emblée comme historique, au commencement en particulier, et lors de la fermentation, lors du développement, cette différence est moins manifeste, ainsi qu’il [en] va nécessairement. Cependant, même du point de vue de la progression, il est indéniable qu’existe bien cette différence entre les deux groupes d’États.
Pour ce qui est de la religion et des lois, chez les peuples du premier type, tout va apparaître plus tôt ; c’est bien plus tôt que le christianisme va se diffuser chez eux ; de même, la constitution va être établie plus tôt, parce qu’ils sont un mélange de Barbares et de peuples civilisés. Au Ve siècle, le code de lois des Ostrogoths a déjà été constitué. Ces peuples sont donc à tous égards en avance de quelques siècles dans le domaine de la civilisation. Pour ce qui est de la littérature, c’est là un aspect qui caractérise plus spécifiquement le second type [d’États], tandis que les premiers, la France, l’Italie et l’Espagne, gardent tous en mémoire la littérature romaine. En Allemagne, les grands poètes ne sont nés que tardivement ; mais ce second groupe d’États va conserver sa spécificité. Cette différence est donc une différence fondamentale, qui ressort avec plus de profondeur encore vers la fin, car l’achèvement de la civilisation consiste simplement en ce que les principes ressortent en toute leur profondeur. Dès lors, aux époques postérieures, ces différences ressortent de la façon la plus tranchée.
Les périodes de l’histoire du monde germanique
L’autre point remarquable, ce sont les époques de l’histoire dont nous nous occupons. Nous avons déjà caractérisé le commencement comme la migration des peuples. Il convient ensuite de [distinguer] trois époques :
1. La domination des Francs de Charlemagne, la domination du royaume universel, de l’empire universel sur les Germains, qui devient par la suite Empire romain. Dans la mesure où l’Empire germanique est à considérer comme l’Empire de cette totalité, nous pouvons y reconnaître les répétitions déterminées des moments antérieurs qui auparavant existaient séparément, de façon autonome. Aussi voit-on y paraître également les époques antérieures. Ainsi l’Empire de Charlemagne est-il comparable à l’Empire perse, à l’Empire de la domination en général et, si on veut le caractériser plus précisément, il est l’Empire de l’unité substantielle, qui n’a plus ici sa signification orientale, mais constitue une unité de ce qui est intérieurement ressenti, une unité naïve de ce qui est [de l’ordre] de l’esprit et du religieux (des Geistig-Geistlichen) et de ce qui est [de l’ordre] du clérico- temporel (des Kirchlich-Weltlichen).
2. La seconde époque est la seconde forme d’unité, qu’il convient de déterminer, de caractériser, par rapport à l’unité réelle qu’est la première unité, comme l’unité idéelle. C’est l’époque de la grande monarchie espagnole de Charles Quint et, plus encore, l’époque qui la précède, où l’unité réelle n’existe plus. Ici, toute particularité est devenue fixe : les royaumes, les États, et en leur sein les états [sociaux : Stände] singuliers avec leur situation particulière et leurs droits particuliers. Dans la mesure où l’unité réelle est ainsi décomposée, le rapport à l’extérieur n’est plus qu’un rapport de politique étrangère. Le rapport devient donc diplomatique. Sans un autre État, aucun État ne peut exister. Entre en scène la représentation de l’équilibre européen. Cette unité est seulement extérieure, ou elle est idéelle en une significafion subordonnée, au sens subordonné où l’unité plus élevée, l’unité idéelle, est celle de l’esprit, celle qui résulte de l’esprit qui revient en soi, à partir de la passion, de la torpeur de la conscience, qui fait retour à l’époque où le monde devient clair à lui-même, y compris dans son étendue extérieure.
C’est donc ici qu’il est question de la découverte de l’Amérique, etc. La religion s’explique dans l’art, elle se clarifie, [et] devient claire à elle-même dans l’élément du sensible. Mais ensuite, au contraire, ce n’est que dans l’élément de l’esprit le plus intérieur, dans la Réforme, qu’elle devient également claire à elle-même. On peut comparer ce temps, cette époque, au monde grec de l’époque de Périclès. De même que ce dernier est à comparer à Léon X, de même le retour en soi de Socrate correspond à Luther. Mais, à vrai dire, à la tête de ce monde, il n’y a aucun Périclès.
Charles Quint dispose d’immenses possibilités en moyens extérieurs, mais il n’a pas ce qui a fait de Périclès un maître : l’esprit intérieur lui fait défaut, il lui manque le moyen absolu de la libre domination. Cette période est donc l’unité idéelle, l’époque où l’esprit devient clair à lui-même. C’est l’époque de la séparation réelle, et c’est là que font leur apparition les deux différences du monde germanique que nous avons indiquées.
3. La troisième période est la période contemporaine, que nous pourrions comparer au monde romain, car l’unité de l’universel y est également présente, non certes comme une hégémonie de l’universalité abstraite, mais comme l’hégémonie de la pensée consciente d’elle-même, qui a vouloir et savoir de l’universel et qui gouverne le monde. À présent, c’est la fin telle que la saisit l’entendement que les gouvernements accomplissent. La fin de l’État telle que la saisit l’entendement est présente. Devant elle, les privilèges disparaissent, ils se dissolvent, et les peuples en prennent conscience ; c’est le droit, le droit en et pour soi qu’il leur faut vouloir, et non le privilège. Ce ne sont donc pas les traités qui lient les peuples, mais les traités reposent maintenant sur des principes. Et de la même penser, la religion peut [maintenant] supporter de concevoir la pensée, l’essence absolue ; ou si elle ne le fait pas, la religion peut supporter, sans avoir atteint la pensée et le concept absolu, de se retirer, de l’extériorité de l’entendement réfléchissant, dans l’identité du sentiment, dans la foi ; mais aussi d’aller jusqu’à la superstition, puisque cette identité peut provenir de la platitude autant que d’un besoin plus élevé et d’un désespoir vis-à-vis de la pensée. Mais c’est encore là, justement, un produit de la pensée.
Voilà donc les trois périodes. Avec ce perfectionnement de l’unité, se forme également en soi le rapport à l’extérieur, qui a cessé toutefois d’être ce qui détermine les époques. Il nous faudra encore développer plus précisément ces moments du rapport [à l’extérieur], il nous faudra les mentionner brièvement à la place qui leur revient.
Islam et monde oriental
C’est donc l’Islam qui, dans son éclat, dans sa liberté, dans son ampleur de vues et sa clarté limpide, s’oppose au monde chrétien enfoncé dans le particularisme. Tous les liens disparaissent. Dans cet Un, toute la particularité de l’Orient est supprimée, toute différence de castes, tout droit de naissance. Il n’y a aucun droit positif, aucune limitation politique des individus. La propriété, la possession, toutes les fins particulières sont sans valeur ; on n’institue rien en fonction de causes et d’effets, et cette absence de valeur, en se réalisant, devient destructrice et dévastatrice. C’est pourquoi l’Islam dévaste tout, convertit tout, conquiert tout.
C’est dans le premier quart du VIIe siècle que l’Islam entre en scène, et il constitue le complément de ce que nous voyons en Occident, le complément du principe de l’Occident. Avec cette foi en l’Un, où la conscience ne reconnaît que l’Un et rien d’autre, avec ce fanatisme, l’Islam peut certes, pour une part être pour soi dans l’indolence ; mais dans la mesure où l’on doit agir, dans la mesure où l’esprit se rapporte à la réalité effective et élève la prétention de s’y réaliser, il lui faut être négatif dans son essence car son caractère est le fanatisme.
[…]
Si un musulman est fourbe, il n’y a rien de plus obstiné dans la fourberie, il la porte en soi des années durant. Si un musulman est vindicatif, le tigre ne saurait être plus sauvage. Il en va de même s’il est cruel, magnanime, sensible, amoureux ; dans ce dernier cas en particulier, il n’est rien de plus concret, de plus intime, de plus intense que cet amour en lequel il vit de façon exclusive.
[…]
Chez les Grecs et les Romains s’est levée, en lien avec l’Orient, l’aurore d’un monde magnifique ; et il en va de même avec le monde chrétien, dont le père naturel est le crépuscule, l’Occident de l’Europe, qui sous son aspect naturel a surgi à l’Ouest. Mais l’Est, l’Orient, est son père au sens plus élevé, son père spirituel. C’est de l’Orient que les Romains ont reçu le christianisme, l’élément de la liberté, de l’universalité, opposé au moment nordique, au fait, typiquement nordique, de prendre appui sur les subjectivités singulières. La bravoure des Européens s’est transformée en une belle chevalerie en Espagne, au contact des Arabes, qui ont également diffusé les sciences, ainsi que les œuvres classiques des Anciens sur lesquelles ils ont exercé de l’influence ; de même, la libre poésie, la libre imagination qui, de nos jours encore, [a été] proposée comme source d’inspiration par Goethe, trouve dans l’Orient son principe fondateur. Récemment encore, Goethe s’est tourné vers l’Orient et il a donné dans son Divan une composition de chants dont l’ardeur s’est embrasée au feu de l’Orient.
Tel est donc le caractère universel de l’Orient ainsi que son rapport à l’Occident. Dans le domaine pratique, nul enthousiasme n’a jamais accompli de plus hauts faits que cet enthousiasme oriental. Cet enthousiasme n’a visé aucun but déterminé, c’est quelque chose de purement abstrait, qui embrasse tout, qui n’a besoin de rien, que rien n’arrête. Sans posséder aucun art de la guerre particulier, il a tout conquis irrésistiblement, de l’Euphrate, des contrées du Tibet jusqu’à la mer Méditerranée ; il a également soumis la Perse, l’Hindoustan et l’Asie centrale, jusqu’à l’Afrique centrale, de même l’ensemble de l’Égypte, et il est arrivé finalement, en passant par l’Espagne, jusqu’à la partie centrale de la France méridionale. C’est seulement à Poitiers que les Arabes [furent] arrêtés et vaincus. De même, ils se dirigèrent, en partant de la Provence, vers l’Italie, vers Nice. En France, ils furent vaincus en 730 par Charles Martel, le grand-père de Charlemagne (son fils était Pépin, qui eut pour fils Charlemagne). Les Arabes possédèrent cette puissance durant un siècle, et c’est tout aussi rapidement que fleurirent chez eux la poésie et toutes les sciences. Sous les grands califes, au IIIe et au IVe siècle (après Mahomet), l’Égypte et l’Asie Mineure se sont remplies de villes florissantes. Au VIIIe siècle (apr. J.-C.), dans toute l’Espagne les villes sont riches, on y trouve les palais les plus splendides. On trouve partout des érudits et des écoles. Toutefois, la cour de Bagdad brillait et se distinguait particulièrement par la magnificence extérieure ainsi que par la poésie et la simplicité des coutumes éthiques. Le plus humble est égal au calife, le plus humble des Sarrasins voyait dans le calife un égal ; ce que l’on pouvait exprimer, grâce à l’orientation naïve de l’esprit. Toutefois ce grand et brillant royaume a rapidement décliné, il ne fut lui aussi que quelque chose d’éphémère, qui s’évanouit sans laisser de trace. Par la suite, sa vaste étendue fut, en grande partie, conquise par les Turcs, qui se sont révélés totalement incapables de la moindre civilisation.
Monde moderne
Pour ce qui concerne encore la civilisation qui intervient maintenant, on peut citer celle du siècle de Louis XIV. La civilisation du siècle de Louis XIV en France est éclatante. C’est un âge d’or, comme l’ont nommé les Français, pour les arts et les sciences. On y voit apparaître des vertus formelles, des vertus qui ont la forme de la dignité, de la grandeur et d’une bienveillance qui entend respecter l’honneur des autres, qui veut satisfaire les autres et se comporter de façon commune [à tous]. On voit également progresser la rhétorique, et les différences au regard du comportement. L’art de la rhétorique se transforme en une sophistique éloquente de la passion. C’est aussi en partie pour ce qui concerne le contenu que ces vertus traditionnelles du discours sont mises en avant. Le contenu de ces discours est bien aussi, certes, une vertu traditionnelle, mais c’est tout aussi bien la passion qui l’est. Le point essentiel cependant est que ne vaille aucun principe véritablement absolu, que l’on ne fasse référence à aucune unité de l’esprit, que l’on ne revienne pas à la liberté, et ces vertus ne proviennent pas de la liberté absolue, de la liberté éthique.
Le point suivant dont il nous faut parler est la forme de civilisation constituée par les sciences, qui font alors leur apparition. La vraie civilisation est essentiellement celle de la science. Elle est du côté de l’État, non pas de l’Église. L’Église ne s’est pas placée au sommet de la liberté religieuse, et pas non plus au sommet de la science, ni dans les sciences expérimentales du penser ni dans celles de la nature extérieure. C’est surtout la science de la nature, l’expérience de la nature extérieure et intérieure, qui se forme en Angleterre et en France. C’est en particulier en France et en Angleterre qu’elle a commencé à apparaître. L’esprit en tant qu’esprit pensant s’est mis en relation avec la nature, puisqu’il a laissé le champ libre à la nature – entendue ici, prosaïquement, comme ce qui est extérieur, ce qu’elle avait laissé aller de soi, librement. L’esprit ne craint plus cette extériorité, et il ne désespère plus, il sait se réconcilier avec l’extérieur, il sait qu’il peut se retrouver soi-même en lui. À ces sciences appartiennent les connaissances de l’existence empirique et plus encore celles des lois universelles de la nature, ce qui est universel dans la nature et dans l’entendement. Ce que l’universel cherche, c’est cela, c’est l’esprit qui, ici, plus précisément, est l’entendement. L’entendement est pour une part mode du penser subjectif, pour une part connexion du monde extérieur.
[…]
Apparaît donc ici le troisième point intéressant. L’entendement, avec sa connaissance, avec ses lois, (a) pour caractéristique de se tourner, en tant qu’Aufklärung, contre ce qui est spirituellement concret, contre ce qui est religieux, en ayant pris pour principe l’être naturel, qu’il s’agisse d’un étant de la nature physique ou d’un étant [de la nature] spirituelle. L’entendement a pour principe fondamental d’ériger les expériences déterminées en ce qui est constitutif du vrai, en pierre de touche de tout ce qui possède une quelconque validité. Son principe est le principe de la cohérence, de l’identité, de la connexion, c’est avec lui qu’il se tourne contre la religion, et c’est ainsi qu’il est l’Aufklärung.
À ses yeux, les lois de la nature sont le vrai et sa méthode est celle de la cohérence. Ce qui est spirituel, les sentiments, les impulsions, [le] sentiment de l’immortalité, la sympathie, etc., appartiennent également à ce qui est présupposé, à ce qui est naturel, à ce qui, à ses yeux, est un donné. Dans la mesure où l’entendement procède à sa façon, il est l’Aufklärung. La religion ne peut lui résister puisque l’entendement s’en tient au naturel comme à ce qui est absolument vrai ; car le principe de la religion est justement que le naturel est le négatif, qu’il faut le supprimer. En outre, la religion est spéculative, la religion a un contenu spéculatif, et elle est donc incohérente lorsqu’on la rapporte à la cohérence abstraite de l’entendement ; car la raison consiste justement à posséder en soi la différenciation comme unité, à saisir ce qui est différent comme un, comme concret, ce qui est l’inverse même de l’identité abstraite, indifférenciée en elle-même, de l’entendement. Mais l’entendement s’en tient là et il dit « le fini n’est pas infini ». Tout ce qu’il y a de mystérieux, c’est-à-dire de spéculatif, dans la religion est un néant à ses yeux. Aussi cette façon de procéder de l’entendement apparait-elle comme négatrice à l’égard de la religion.
Toutefois c’est un second aspect, différent, que la relation de l’entendement en général à l’État. Dans la mesure où l’État et le gouvernement possèdent de l’entendement et saisissent leur activité comme une fin universelle, dans la mesure où ils s’appréhendent eux-mêmes comme quelque chose d’universel, surgit la représentation d’une fin universelle de l’État comme fin suprême, comme fin valide. Cette pensée de la fin de l’État doit d’abord écarter ce qui, au regard des rapports étatiques, relève du simple droit privé, elle doit écarter ce qui, au sein du pouvoir, ne possède sa légitimation que dans la particularité. Dans la mesure où l’État devient ainsi pensant, il acquiert une autre situation au sein de la réalité effective. Ce qui constituait des privilèges ne vaut plus à présent en et pour soi comme possédant la forme de la propriété privée. Selon le concept, selon le contenu, tous les rapports qui selon la forme sont des rapports de droit privé appartiennent à l’État. Aussi, ce contenu est-il soustrait au droit privé. Seul ce qui de par sa nature peut relever du droit privé est en droit de conserver cette forme.
Maintenant, le gouvernement saisit la fin, la pensée de l’État, et puisque cet aspect a fait son apparition, il nous faut ici mettre en relief la figure de Frédéric II. C’est un personnage de l’histoire mondiale, on l'[a] nommé « le roi philosophe », parce qu’il avait saisi la pensée universelle de l’État, parce qu’il s’en est tenu à la fin universelle. On aurait tout aussi bien pu le nommer ainsi parce qu’il s’occupait de métaphysique, ou parce que, en tant que personne privée, il était philosophe. Mais il n’est pas le roi philosophe parce qu’il est exclusivement philosophe, il l’est parce que, le premier, il a saisi ce principe, et l’a mis à exécution en tant que roi. C’est seulement lorsque celui-ci a acquis une validité universelle que la philosophie peut être qualifiée de bon sens (gesunder Menschenverstand). Frédéric II fut celui qui s’en tint à la fin de l’État et qui lui donna sa validité, et c’est pourquoi il ne s’est plus contenté de rejeter le particulier, les privilèges particuliers, comme opposés à la fin de l’État, comme contraires à sa conservation. Il leur a préféré des institutions qui étaient avantageuses pour le tout.
[…]
La question est alors de savoir sous quelle détermination et sous quelle forme cette manifestation [a] surgi, sous quelle détermination et sous quelle forme se manifeste la révolution. Le penser est devenu violence [Gewalt] là où il a trouvé face à soi le positif comme violence absolue [absolute Gewalt]. Aussi voyons-nous éclater des révolutions en France, en Italie, à Naples, au Piémont ainsi que dernièrement en Espagne, c’est-à-dire dans tous les États que nous avons qualifiés de romans. En revanche, dans ceux où la liberté de l’Église évangélique était instituée auparavant, le calme a subsisté. Car, avec leur réforme religieuse, ces pays ont en même temps opéré leur réforme politique, leur révolution. L’affaire essentielle dans les pays romans est de renverser le trône, entreprise qui réussit, puis est anéantie à son tour. Il faut souligner que dans ces révolutions, on ne fait que des révolutions politiques, sans changement religieux. La religion en sort au contraire tantôt amoindrie, tantôt renforcée en ce qui concerne la liberté de l’esprit. Mais sans changement religieux, aucun véritable changement politique, aucune révolution ne peut réussir. La liberté de l’esprit, les principes de la liberté qui, dans ces pays, ont été érigés en principes de la constitution sont déjà eux-mêmes abstraits, dans la mesure où ils sont nés d’une opposition à ce qui existait positivement et ne sont pas issus de la liberté de l’esprit telle qu’elle existe dans la religion. Aussi n’a-t-on pas affaire ici à la liberté de l’esprit telle qu’elle existe dans la religion, à la liberté qui est la liberté divine et véritable.
Les pays de l’Église évangélique ont donc déjà opéré leur révolution ; dans les pays de l’Église évangélique, la révolution est achevée ; car [en] eux est présente l’idée que ce qui doit arriver arrive par la compréhension et par la culture universelle, dans le calme. Il n’y a pas ici de contradiction absolue, qui irait contre la pensée de la fin concrète de l’État. En revanche, dans les autres pays, dans les pays romans, même ce qui est contraire aux déterminations de la fin de l’État possède une légitimité si absolue qu’il est en mesure d’opposer une résistance absolue. Les pays évangéliques, les pays protestants, diffèrent grandement par leur constitution extérieure. Par exemple le Danemark, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse sont totalement différents ; mais en tous est présent le même principe essentiel : ce qui doit valoir dans l’État doit procéder de la compréhension, de la fin universelle de l’État, et c’est en cela que réside sa légitimité. Telle est, en un sens abstrait, la détermination nécessaire.
G.W.F Hegel, La philosophie de l’histoire, trad. Myriam Bienenstock, Christophe Bouton, Jean-Michel Buée, Gilles Marmasse, David Wittman, Paris, Le livre de poche, 2009, p.207 ; pp.208-209 ; 244-246 ; p.299 ; pp.300-301 ; pp.304-305 ; p.367 ; p.369 ; p.370 ; p.384 ; p.430-432 ; pp.470-471 ; pp.474-479 ; pp.486-487 ; pp.486-488 ; pp.488-489 ; pp.531-532 ; pp.534-535 ; pp.537-538