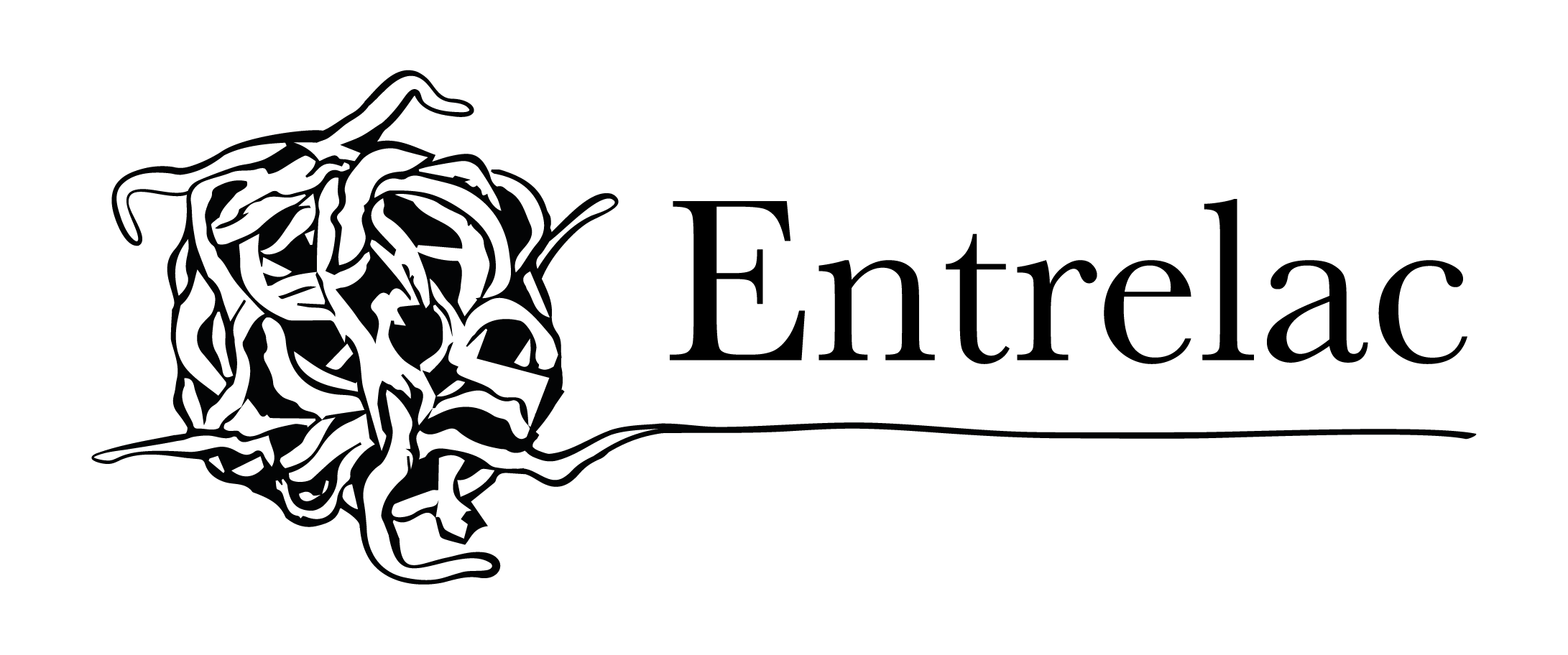Celui qui a le plus de pied
Chez toutes les créatures et toutes les formes, le pied est ce qui touche la terre et donne l’assiette, ce qui s’étale largement, comme dans les montagnes, les arbres et chez tous les animaux pour qui le langage procède d’une manière plutôt topographique qu’anatomique lorsqu’il en dénomme les membres. Ainsi, le « pied » de l’escargot constitue presque la totalité de son corps. Au contraire, on dit du serpent qu’il rampe sur le ventre. Dans de tels repérages, le corps humain sert toujours de mesure, d’étalon, et souvent, comme en ce cas, en vertu de la plus vague des analogies. Si l’on prend pour signe distinctif du pied le contact avec la terre, on pourrait dire que de tous les animaux c’est le serpent qui, par rapport à sa surface totale, a le plus de pied et qui, par suite, est le plus éloigné de l’attitude humaine. Aussi est-il, de toutes les créatures, la plus animale – c’est en lui que le signe de l’animalité ressort le plus clairement. D’où le brusque effroi qui s’empare de l’homme à sa vue, mais aussi sa réputation d’être le plus rusé des animaux. Il est vrai que cette sorte de ruse n’a rien à voir avec l’intelligence humaine ; c’est une ratio du sol, une vertu spirituelle chtonienne. Le serpent est, plus que tout autre être, affermi dans son contact avec le sol ; d’où son rôle d’animal d’Esculape, de symbole de cette santé qui réside dans les sources de la terre et dont parle la question : come sta ? Et de même, le serpent est l’emblème de ce qui, vu des hauteurs de l’esprit, paraît bas : de la furieuse soif de puissance et de trésors, de la volupté corporelle. Comme image première de la force chtonienne, il apparaît dès les plus anciens jours : menant les fils de Gaïa dans leur terrible révolte, comme sur la frise de l’autel de Pergame, gardant les trésors, sous forme de dragon, comme dans la caverne de Fafnir, ou, sous l’arbre de la Connaissance, offrant à l’homme « la Cène terrestre ! ». En tous lieux où la loi ancienne et la loi ancestrale, où la pure vertu de la Terre dominent, dans le mythe et les cultes des premiers âges, on rencontrera la vénération du serpent, voire l’adoration de cet animal ; et on ne trouvera jamais non plus d’ordre dont il soit absent. Nulle hauteur n’est concevable sans profondeur ; le serpent a sa place au pied de la croix.
Ernst Jünger, Le contemplateur solitaire, trad. Henri Plard, Paris, Grasset, 1975, pp.75-76.