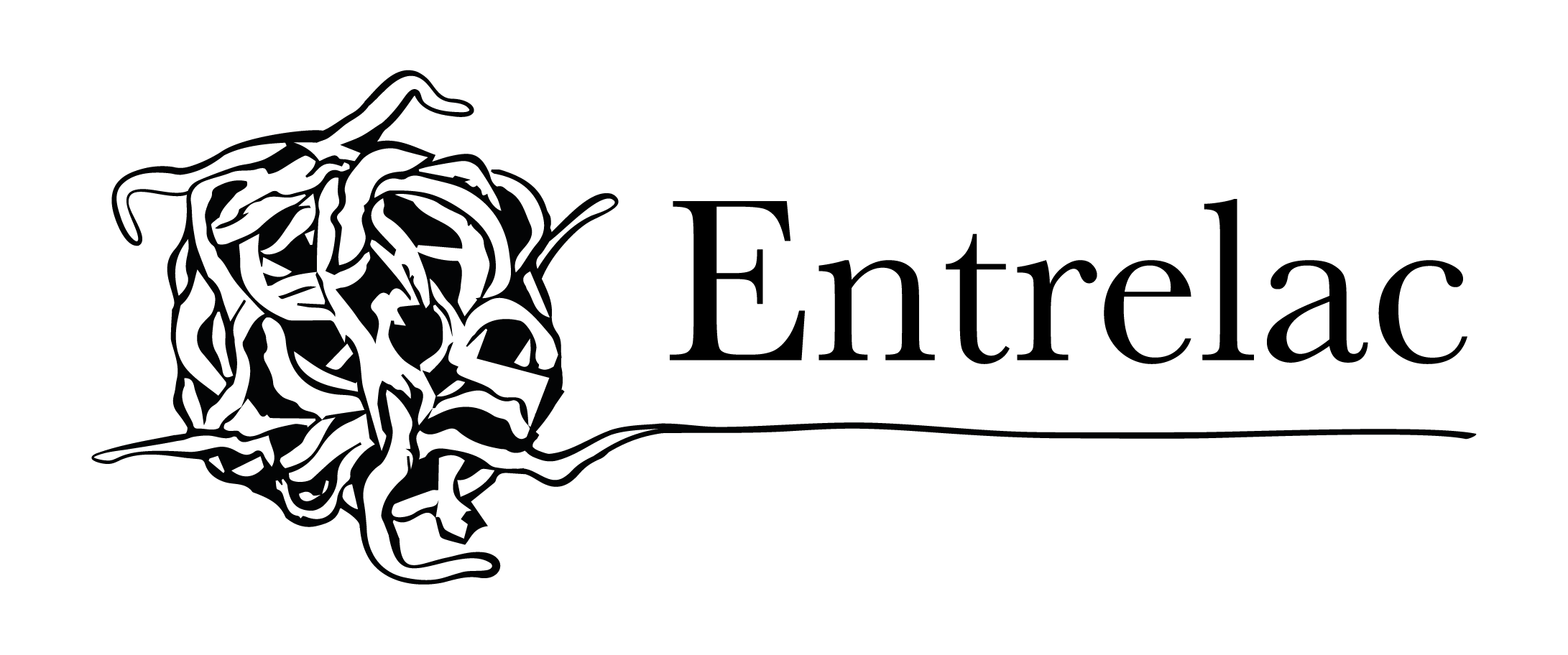La genèse du structuralisme
Le terme « structure » a pris en linguistique, au cours de ces vingt dernières années, une extension considérable depuis qu’il a acquis une valeur doctrinale et en quelque sorte programmatique. Ce n’est plus tant du reste structure qui apparaît désormais comme le terme essentiel que l’adjectif structural, pour qualifier la linguistique. Très vite structural a entraîné structuralisme et structuraliste. Il s’est créé ainsi un ensemble de désignations que d’autres disciplines empruntent maintenant à la linguistique pour les adapter à leurs propres valeurs. On ne peut parcourir aujourd’hui le sommaire d’une revue de linguistique sans y rencontrer un de ces termes, souvent dans le titre même de l’étude. Que le souci d’être « moderne » ne soit pas toujours étranger à cette diffusion, que certaines déclarations « structuralistes » couvrent des travaux de nouveauté ou d’intérêt discutable, on l’admettra sans peine. L’objet de la présente note n’est pas de dénoncer l’abus, mais d’expliquer l’usage. Il ne s’agit pas d’assigner à la linguistique « structurale » son champ et ses bornes, mais de faire comprendre à quoi répondait la préoccupation de la structure et quel sens avait ce terme chez ceux des linguistes qui, les premiers, l’ont pris dans une acception précise.
Le principe de la « structure » comme objet d’étude a été affirmé, un peu avant 1930, par un petit groupe de linguistes qui se proposaient de réagir ainsi contre la conception exclusivement historique de la langue, contre une linguistique qui dissociait la langue en éléments isolés et s’occupait à en suivre les transformations. On s’accorde à considérer que ce mouvement prend sa source dans l’enseignement de Ferdinand de Saussure à Genève, tel qu’il a été recueilli par ses élèves et publié sous le titre de Cours de linguistique générale. On a appelé Saussure avec raison le précurseur du structuralisme moderne. Il l’est assurément, au terme près. Il importe de noter, pour une description exacte de ce mouvement d’idées qu’il ne faut pas simplifier, que Saussure n’a jamais employé, en quelque sens que ce soit, le mot « structure ». A ses yeux la notion essentielle est celle du système. La nouveauté de sa doctrine est là, dans cette idée, riche d’implications qu’on mit à discerner et à développer, que la langue forme un système. C’est comme telle que le Cours la présente, en formulations qu’il faut rappeler : « La langue est un système qui ne connaît que son ordre propre » (p. 43) ; « La langue, système de signes arbitraires » (p. 106) ; « La langue est un système dont toutes les parties peuvent et doivent être considérées dans leur solidarité synchronique » (p. 124). Et surtout, Saussure énonce la primauté du système sur les éléments qui le composent : « C’est une grande illusion de considérer un terme simplement comme l’union d’un certain son avec un certain concept. Le définir ainsi, ce serait l’isoler du système dont il fait partie ; ce serait croire qu’on peut commencer par les termes et construire le système en en faisant la somme, alors qu’au contraire c’est du tout solidaire qu’il faut partir pour obtenir par analyse les éléments qu’il renferme » (p. 157). Cette dernière phrase contient en germe tout l’essentiel de la conception « structurale ». Mais c’est toujours au système que Saussure se réfère.
Cette notion était familière aux élèves parisiens de Saussure ; bien avant l’élaboration du Cours de linguistique générale, Meillet l’a énoncée plusieurs fois, sans manquer de la rapporter à l’enseignement de son maître, dont il disait que « durant toute sa vie, ce qu’il a cherché à déterminer, c’est le système des langues qu’il étudiait ». Quand Meillet dit que « chaque langue est un système rigoureusement agence, où tout se tient », c’est pour attribuer à Saussure le mérite de l’avoir montré dans le système du vocalisme indo-européen. Il y revient plusieurs fois : « Il n’est jamais légitime d’expliquer un détail en dehors de la considération du système général de la langue où il apparaît » ; « Une langue constitue un système complexe de moyens d’expression, système où tout se tient… » De même Grammont louait Saussure d’avoir montré « que chaque langue forme un système où tout se tient, où les faits et les phénomènes se commandent les uns les autres, et ne peuvent être ni isolés ni contradictoires ». Traitant des « lois phonétiques », il proclame : « Il n’y a pas de changement phonétique isolé… des articulations d’une langue constitue en effet un système où tout se tient, où tout est dans une étroite dépendance. Il en résulte que si une modification se produit dans une partie du système, il y a des chances pour que tout l’ensemble du système en soit atteint, car il est nécessaire qu’il reste cohérent. »
Ainsi, la notion de la langue comme système était depuis longtemps admise de ceux qui avaient reçu l’enseignement de Saussure, en grammaire comparée d’abord, puis en linguistique générale. Si on y ajoute ces deux autres principes, également saussuriens, que la langue est forme, non substance, et que les unités de la langue ne peuvent se définir que par leurs relations, on aura indiqué les fondements de la doctrine qui allait, quelques années plus tard, mettre en évidence la structure des systèmes linguistiques.
Cette doctrine trouve sa première expression dans les propositions rédigées en français que trois linguistes russes, R. Jakobson, S. Karcevsky, N. Troubetzkoy, adressaient en 1928 au Ier Congrès international de Linguistes à La Haye en vue d’étudier les systèmes de phonèmes. Ces novateurs devaient eux-mêmes désigner ceux qu’ils considéraient comme leurs précurseurs, Saussure d’une part, Baudoin de Courtenay de l’autre. Mais déjà leurs idées avaient pris forme autonome, et dès 1929 ils les formulaient en langue française dans les thèses publiées à Prague pour le Ier Congrès des Philologues slaves. Ces thèses anonymes qui constituaient un véritable manifeste, inauguraient l’activité du Cercle linguistique de Prague. C’est là que le terme structure apparaît, avec la valeur que plusieurs exemples vont illustrer. Le titre énonce : « Problèmes de méthode découlant de la conception de la langue comme système » et en sous-titre : « …comparaison structurale et comparaison génétique ». On préconise « une méthode propre à permettre de découvrir les lois de structure des systèmes linguistiques et de l’évolution de ceux-ci ». La notion de « structure » est étroitement liée à celle de « relation » à l’intérieur du système : « Le contenu sensoriel de tels éléments phonologiques est moins essentiel que leurs relations réciproques au sein du système (principe structural du système phonologique) ». D’où cette règle de méthode : « Il faut caractériser le système phonologique… en spécifiant obligatoirement les relations existant entre lesdits phonèmes, c’est-à-dire en traçant le schème de structure de la langue considérée. » Ces principes sont applicables à toutes les parties de la langue, même aux « catégories de mots, système dont l’étendue, la précision et la structure intérieure (relations réciproques de ses éléments) doivent être étudiées pour chaque langue en particulier ». « On ne peut déterminer la place d’un mot dans un système lexical qu’après avoir étudié la structure du dit système. » Dans le recueil qui contient ces thèses, plusieurs autres articles de linguistes tchèques (Mathesius, Havránek), écrits en français aussi, contiennent le mot « structure ».
Émile Benveniste, Problèmes de linguistiques générale 1, Paris, Gallimard, coll. « tel », 1966, pp.91-94.