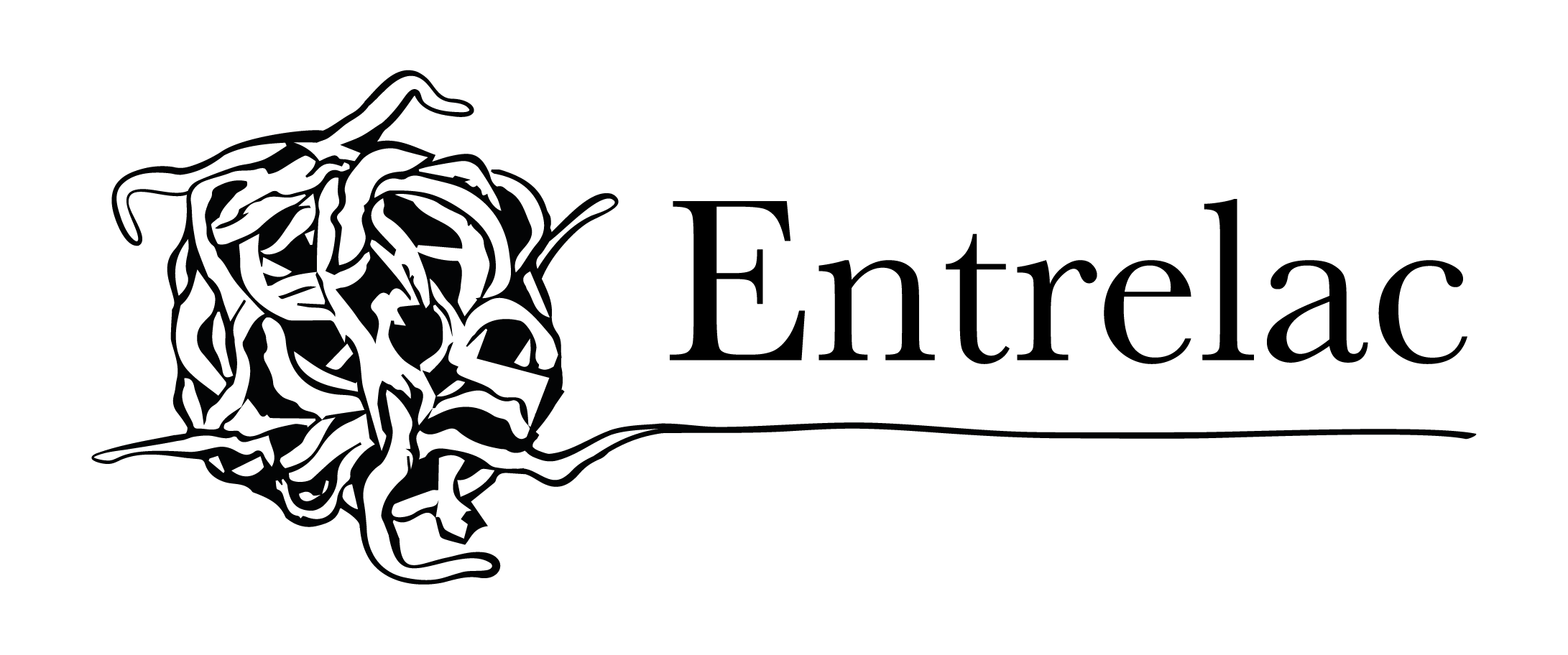La tour aux Sarrasins
Dans le panorama que je découvrais de la Tour aux Sarrasins, j’avais été frappé, hier, par une ruine que les insulaires qualifient de Castello Turco. Je m’y suis rendu aujourd’hui. Une falaise marine portait ce château jadis guerrier – mais maintenant en ruine, depuis longtemps. Je suis resté debout dans sa grand-salle, ouverte vers le ciel, au-dessus de laquelle voletait un faucon.
Qui est entré et sorti par ces portails ? Qui a banqueté dans ces salles, tandis que jouaient les musiciens ? A quoi ressemblaient la fondation, le beau temps, le déclin de la forteresse maritime ? A-t-elle été forcée et détruite, ou bien le respect de ses maîtres s’est-il, comme ses pierres, effrité peu à peu ? Ce sont des pensées qui nous absorbent et nous attirent d’autant plus que les traditions sont plus obscures. Nous les sentons, en de tels endroits, frôler nos fronts comme des ailes – la douleur, une nostalgie jamais apaisée se dissimulent derrière la passion de l’histoire.
Mais la beauté baigne toujours ces décombres vétustes, et l’on se demande pourquoi nos bâtiments, comparés à ceux de presque tous les passés, doivent au fond être nécessairement d’une pareille laideur ? Nous ne pouvons contester cette hideur et serions contraints, si l’on nous défiait de soutenir ces comparaisons, d’invoquer d’autres témoignages que les édifices. Chez nous, tout est moyen en vue d’une fin, et il y a bien peu d’installations. C’est ainsi que se modifie le rapport, dans lequel le dynamisme assigne au monde ses formes. Ici survient l’épiphanie des mystères mathématiques, qui agit sur l’esprit comme la vue de la beauté toute nue sur les sens. Derrière le triomphe des moyens sur l’espace, le regard entrevoit celui de l’esprit sur l’espace. Il y scintille, il se mire en eux comme dans le bouclier d’airain d’Achille.
Chose étrange que cette cohabitation de l’impuissance dans le statisme et de la virtuosité du dynamisme. On peut souvent l’observer en l’espace de quelques minutes, devant le panorama d’une de nos villes grises, où il n’est rue ni maison qui n’offense les yeux. Comme tout cela change avec l’obscurité ! Les constructions s’effacent, abolies par les lumières. Rues et places se métamorphosent en rangées et rubans lumineux, en touffes lumineuses et en courbes multicolores. Comme les rayons d’une étoile, pistes de circulation et faisceaux de rails s’étalent, et luit le tourbillon lumineux des aérodromes. Cette métamorphose entraîne, en même temps, une libération ; nous pénétrons dans le monde des jeux et des danses. Si les aïeux lointains revenaient vers nous, voilà ce que nous pourrions leur montrer, vision, radiographie d’intentions à nous-mêmes cachées.
Les murailles du château reposent sur des bancs de granit arrosés par la mer. Des rubans noirs, pareils à des règles d’écolier, y sont enclavés ; je suppose que c’est à eux que ce promontoire doit son nom de Capo Carbonaro. Pourtant, bien évidemment, il ne s’agit pas de charbon, mais d’une pierre volcanique lisse, d’une grande pesanteur, qui s’est répandue couche par couche sur le rocher. Plus tard, des dislocations de la roche les ont redressées à la verticale
Le chemin du retour, lui aussi, passait sur de longues distances par-dessus ce granit lisse, coupé çà et là de rubans de cristaux. La pierre est de couleur « poivre et sel » ; son poli la rend aveuglante. Des bancs d’une extraordinaire dureté alternent avec des endroits où le roc s’est désagrégé. Il ne peut s’agir là de l’action des éléments, puisqu’on n’aperçoit pas de transitions, mais de qualités différentes dès l’origine. On pourrait s’imaginer qu’il y a eu dans la grande marmite des endroits où la cuisson de la roche primitive « n’a pas pris ». Il manque à ces places dégradées le lustre des autres : l’œil s’irrite à les rencontrer. Tandis que j’y songeais, je vis un lézard qui s’était élancé sur la surface lisse comme sur une piste se mettre à trébucher quand il tomba dans le gravier. Ce malaise est profondément enfoncé dans la matière.
Sur la rive de la lagune opposée au côté de la mer, je fis halte dans une prairie couverte d’arbustes hauts, semblables au fenouil. Tandis que j’en dessinais un dans mon carnet, je vis sortir d’une haie d’oponces un vieillard qui faisait paître ici ses vaches. Il me demanda à quoi tendait mon occupation et répondit lui-même aussitôt et exactement à sa question : è per conoscere la specialità ? Sur quoi je lui demandai s’il connaissait le nom de cette plante, et l’entendis l’appeler fe-urra. Il s’agissait donc, comme je m’en étais douté, d’une sorte de ferula. Il ajouta qu’elle n’était pas buono per i cristiani, donc vénéneuse, ce qui d’ailleurs se voyait au fait que le bétail l’avait dédaignée.
Le bouvier avait pris part à la première guerre mondiale et avait été blessé près d’Udine ; dans la seconde, il a perdu son fils à Pantellaria. Toujours la même chanson. Il était jaune, chétif, et parlait comme tant de vieillards d’un ton gémissant, mais en accusant le destin plutôt que les hommes. Malaria cronica. Il pensait que dans la bourgade, il n’y avait que peu de gens à ne pas l’avoir. Surprise pour moi, car, à ma question, ils avaient contesté la présence même de cette maladie, et cela avec l’ardeur qu’on met à se défendre contre une calomnie.
En fait, depuis deux ou trois ans, on a accompli de grands efforts pour combattre la malaria. Sur toutes les maisons, les étables, les puits, et même les ruines, on trouve présents des signes du groupe de désinfection. Jusqu’à nos jours, l’ile a hébergé toute une série de repaires de la fièvre parmi les plus mal famés d’Europe, surtout là où les côtes se perdent dans les bas-fonds et sont parsemées de stagni, vrais couvoirs de moustiques. Près de tels marais, au bord desquels le vieux a, lui aussi, dressé sa minable cabane de roseaux, l’homme ne peut que traîner son existence de malade. Au contraire, les buffles qu’il y mène paître sont superbes, énormes et d’un brun doré, comme le troupeau d’Hélios.
Ernst Jünger, Le contemplateur solitaire, trad. Henri Plard, Paris, Grasset, 1975, pp.152-155.