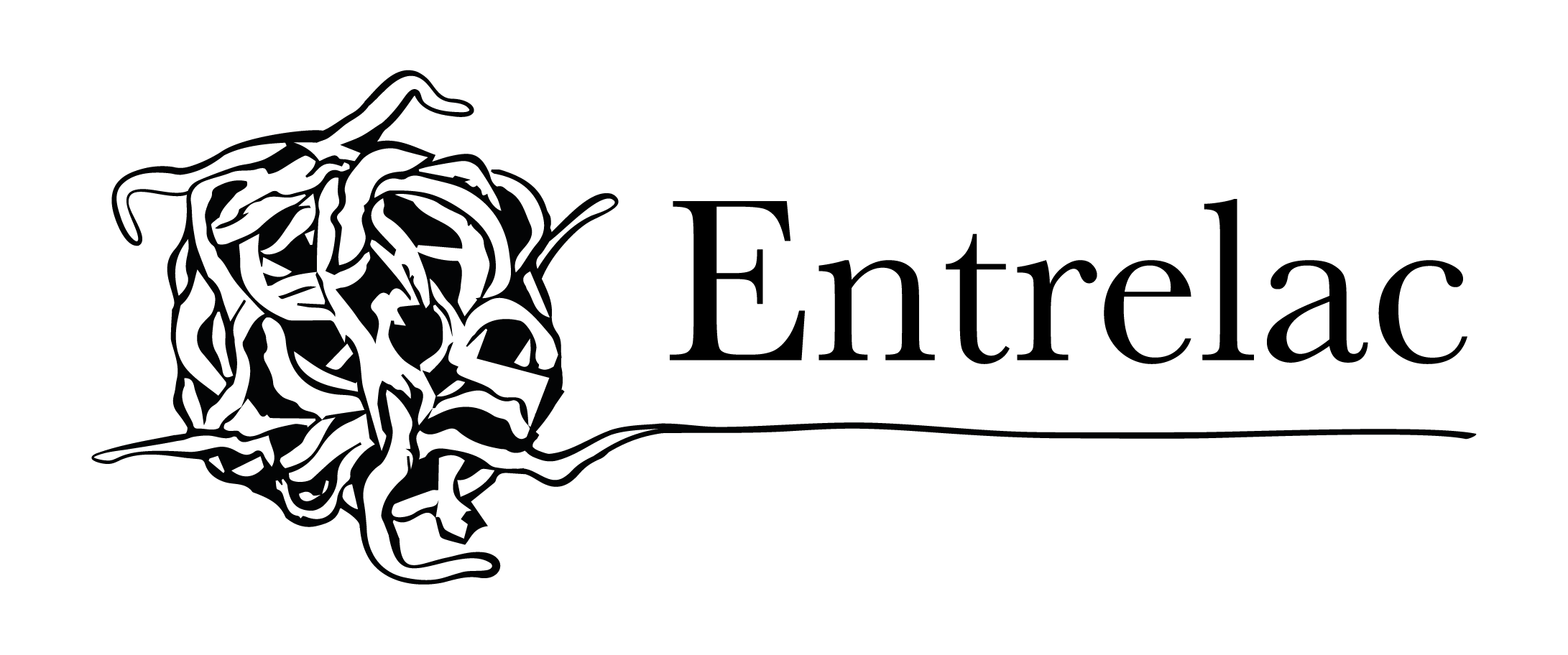Un chevalier sans nom
Le roman – Perceval vit un vol d’oies sauvages que la neige avait éblouies. (…) Le faucon en a trouvé une, abandonnée de cette troupe. Il l’a frappée, il l’a heurtée si fort qu’elle s’en est abattue. (…) Et Perceval voit à ses pieds la neige où elle s’est posée et le sang encore apparent. Et il s’appuie dessus sa lance afin de contempler l’aspect du sang et de la neige ensemble. Cette fraîche couleur lui semble celle qui est le visage de son amie. Il oublie tout tant il y pense, car c’est bien ainsi qu’il voyait sur le visage de sa mie, le vermeil posé sur le blanc comme les trois gouttes de sang sur la neige paraissaient. (…) Nous avons vu un chevalier qui dort debout sur sa monture. Tout y est : la redondance propre au visage et au paysage, le mur blanc neigeux du paysage-visage, le trou noir du faucon ou des trois gouttes distribuées sur le mur ; ou bien en même temps la ligne argentée du paysage-visage qui file vers le trou noir du chevalier, profonde catatonie. Et parfois aussi, dans certaines circonstances, le chevalier ne pourra-t-il pas pousser le mouvement toujours plus loin, traversant le trou noir, perçant le mur blanc, défaisant le visage, même si la tentative retombe ? Tout ceci ne marque nullement une fin du genre romanesque, mais est là dès le début et lui appartient essentiellement. Il est faux de voir dans Don Quichotte la fin du roman de chevalerie, en invoquant les hallucinations, les fuites d’idées, les états hypnotiques ou cataleptiques du héros. Il est faux de voir dans les romans de Beckett la fin du roman en général, en invoquant les trous noirs, la ligne de déterritorialisation des personnages, les promenades schizophréniques de Molloy ou de l’Innommable, leur perte de nom, de souvenir ou de projet. Il y a bien une évolution du roman, mais elle n’est sûrement pas là. Le roman n’a pas cessé de se définir par l’aventure de personnages perdus, qui ne savent plus leur nom, ce qu’ils cherchent ni ce qu’ils font, amnésiques, ataxiques, catatoniques. C’est eux qui font la différence entre le genre romanesque et les genres dramatiques ou épiques (quand le héros épique ou dramatique est frappé de déraison, d’oubli, etc., il l’est d’une tout autre manière). La princesse de Clèves est un roman précisément pour la raison qui parut paradoxale aux contemporains, les états d’absence ou de « repos », les sommeils qui frappent les personnages : il y a toujours une éducation chrétienne dans le roman. Molloy est le début du genre romanesque. Quand le roman commence, par exemple avec Chrétien de Troyes, il commence par le personnage essentiel qui l’accompagnera dans tout son cours : le chevalier du roman courtois passe son temps à oublier son nom, ce qu’il fait, ce qu’on lui dit, ne sait où il va ni à qui il parle, ne cesse de tracer une ligne de déterritorialisation absolue, mais aussi d’y perdre son chemin, de s’arrêter et de tomber dans des trous noirs. « Il attend chevalerie et aventure. » Ouvrez Chrétien de Troyes à n’importe quelle page, vous trouverez un chevalier catatonique assis sur son cheval, appuyé sur sa lance, qui attend, qui voit dans le paysage le visage de sa belle, et qu’il faut frapper pour qu’il réponde. Lancelot devant le blanc visage de la reine ne sent pas son cheval s’enfoncer dans la rivière ; ou bien il monte dans une charrette qui passe, il se trouve que c’est la charrette d’infamie. Il y a un ensemble visage-paysage qui appartient au roman, et où tantôt les trous noirs se distribuent sur un mur blanc, tantôt la ligne blanche d’horizon file vers un trou noir, et les deux à la fois.
Giles Deleuze et Felix Guattari, Mille plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980, pp.212-214.